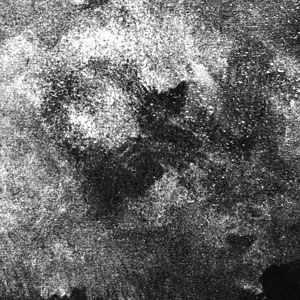Absence de politique, politique de l’absenceessai sur les Chroniques littéraires de Maurice Blanchotpendant la Seconde Guerre mondiale
0. Introduction
Durant la Seconde Guerre mondiale, Maurice Blanchot (1907-2003) ne cesse d’écrire des chroniques littéraires dans le Journal des débats politiques et littéraires, d’avril 1941 à août 1944, tout en publiant ses deux premiers romans, Thomas l’Obscur (1941) et Aminadab (1942)[1]. Après s’être engagé dans le journalisme politique d’extrême droite dans les années 1930 ── notamment au sein de la « Jeune Droite », issue de l’Action Française ── Blanchot se détourne de cette sphère et se consacre exclusivement à la littérature. Il ne publiera plus de texte politique jusqu’en 1958, lorsqu’il manifeste, aux côtés de Dionys Mascolo, un refus catégorique face à la politique du général de Gaulle.
Les chroniques littéraires de Blanchot publiées sous l’Occupation dans une rubrique intitulée Chronique de la vie intellectuelle ont suscité, ces dernières années, plusieurs lectures critiques, témoignant d’une diversité d’interprétations quant à leur portée[2]. Si des divergences de vues existent, un consensus semble toutefois émerger : on y lit souvent l’affirmation d’une indifférence apparente à la situation politique. Ses articles se concentrent exclusivement sur des œuvres contemporaines sans jamais faire mention explicite du contexte historique ni soumettre ces œuvres à une évaluation idéologique, au sein d’un journal corrompu par l’idéologie de Vichy et même par celle des Nazis[3]. On y discerne également l’idée d’une évolution progressive du chroniqueur vers l’auteur que nous connaissons[4] : ainsi, l’année 1941 serait encore marqué par une certaine distance, tandis que l’année 1944 porterait déjà les signes d’une posture plus affirmée[5].
Toutefois, une telle lecture appelle des réserves. En premier lieu, l’idée d’une stricte indifférence politique mérite d’être nuancée : dans ses deux premiers articles d’avril 1941, Blanchot laisse échapper des allusions à la guerre. Ensuite, en décembre 1943, lors de la publication de Faux pas, Blanchot n’a jamais relégué son article d’avril 1941 à une simple chronique de circonstance, mais l’a élevé au rang de texte fondateur. Car l’un des articles les plus précoces de sa Chronique, publié le 23 avril 1941[6] et consacré à Vie de Mallarmé d’Henri Mondor[7], sera repris dans le recueil critique, où il inaugure la section « Digression sur la poésie ». Ce texte, intitulé « Le Silence de Mallarmé »[8], y apparaît comme une pièce essentielle, au même titre que « Mallarmé et l’art du roman », publié en octobre 1943 et placé en ouverture de la section « Digression sur le roman ».
À partir de cette observation, il convient de revenir aux chroniques littéraires d’avril 1941. Nous examinerons d’abord la manière dont Blanchot inaugure sa Chronique en formulant une stratégie de lecture. Nous verrons ensuite comment cette stratégie se manifeste dans son approche des œuvres contemporaines, en particulier dans sa lecture de Vie de Mallarmé (1941-1942). Et enfin, nous finirons en commentant sa conception de la critique cristallisée dans une prière d’insérer de Faux pas (1943). À travers ces trois moments de lecture, nous chercherons à mettre en évidence une forme critique cohérente, que nous proposons de nommer : politique de l’absence.
1. Stratégie de Chronique de la vie intellectuelle
Les peuples meurtris qui ne peuvent exprimer les sentiments qui les agitent se rejettent dans la lecture. Ils cherchent notamment dans les livres, même difficiles, une explication de ce qu’ils sont[9].
C’est par ces mots que Blanchot inaugure, le 16 avril 1941, sa Chronique de la vie intellectuelle, suggérant d’emblée une corrélation entre l’expérience historique de la défaite et un surcroît d’intérêt pour la lecture. Il évoque une « étrange fièvre de connaissance » qui s’empare de la France après la débâcle, portée par les efforts des éditeurs désireux de répondre à cette soif de livres. En cela, Blanchot fait implicitement allusion à la situation du Journal des débats lui-même, contraint de se replier de Paris à Clermont-Ferrand dès le 15 juin 1940 pour survivre grâce à un financement du gouvernement Vichy. Dans les paragraphes suivants, il dresse un inventaire des publications récentes : récits de guerre, romans, biographies, anthologies poétiques, cahiers et traductions, offrant ainsi un panorama de la production littéraire contemporaine.
De prime abord, Blanchot s’inscrit dans le rôle traditionnel du chroniqueur. Cependant, après cinq paragraphes consacrés à cette revue d’ouvrages, la dernière partie du texte marque une rupture. Blanchot y dépasse le cadre d’une simple chronique littéraire, opérant un geste que l’on pourrait qualifier d’auto-référence, de négation de soi ou encore de rétraction.
Cette rapide revue laisse ignorer le vrai mouvement des esprits pendant ces mois si étranges. […] Beaucoup d’écrivains, c’est un fait, se sont condamnés au silence, moins à cause des difficultés extérieures qu’ils pouvaient rencontrer qu’en raison d’une véritable épreuve de stérilité. Ils se sont tus et ils continuent à se taire parce qu’ils croient qu’ils n’ont plus rien à dire. Une nuit aride est tombée sur eux. Après de nombreuses années où ils s’agitent vainement, ils ont enfin entendu leur propre silence[10].
Par ces lignes, Blanchot affirme que l’énumération des livres publiés ne suffit pas à rendre compte du véritable état de la vie intellectuelle. Il introduit ainsi une autre dimension critique, qui ne se limite pas à opposer les œuvres publiées à une situation historique plus ou moins défavorable, mais qui engage une réflexion plus profonde : il ne s’agit pas tant de la censure ou des obstacles politiques extérieurs que d’une conscience intime de l’impuissance du langage après le désastre[11].
Cette réflexion trouve un écho dans le compte rendu, bref mais particulièrement élogieux, que Blanchot vient de consacrer à Vie de Mallarmé dans ce même article. Par un détour, il semble y faire allusion à l’état d’impuissance des écrivains contemporains. Il écrit ainsi :
C’est aujourd’hui pour l’esprit une facile mais agréable revanche que de contempler un homme qui, dans une complète et obscure solitude, sut dominer le monde par l’exercice pur d’un pouvoir d’expression absolu[12].
L’interprétation du terme « revanche » demeure certes délicate, mais une chose apparaît clairement : Blanchot met en lumière une distance infranchissable entre le langage des écrivains après la défaite et celui de Mallarmé, tel que le révèle l’ouvrage de Mondor. Loin de pouvoir s’élever à la hauteur du « pouvoir d’expression absolu » qu’incarne Mallarmé, la parole littéraire sous l’Occupation semble marquée par une vacuité presque irrémédiable. La grandeur du poète ne fait que rendre plus sensible l’épuisement du langage contemporain[13].
Cette question du silence prend une résonance particulière si l’on considère l’évolution de Blanchot lui-même. Dans les années trente, engagé dans le journalisme politique d’extrême droite, il croyait possible d’agir sur le monde par le langage, en particulier par le mot privilégié « révolution »[14]. Or, dans ce texte du 16 avril 1941, la posture a changé : l’idée d’une parole impuissante traverse ses premières chroniques. Cette réflexion s’affirme encore davantage dans l’article publié trois jours plus tard, le 19 avril 1941, sous le titre « Silence des écrivains ». Là encore, Blanchot médite sur « ces saisons au cours desquelles les livres n’ont paru que la frange d’un laborieux silence », et évoque l’artiste qui a « à toutes les époques difficiles, éprouvé des doutes sur lui-même qui le conduisent à la manifestation de son impuissance »[15].
Pourtant, cette attitude ne relève ni de la résignation ni d’un pathos mélancolique. Elle s’inscrit plutôt dans une exigence intransigeante qui constitue, en soi, un véritable geste critique. Dès son premier article, Blanchot instaure un double discours : d’une part, rendre compte des œuvres contemporaines ; d’autre part, faire entendre un silence qui devient d’autant plus perceptible que les mots s’accumulent. Il ne s’agit pas seulement d’exposer des livres, mais de les accompagner dans leur propre retrait et de leur faire dire plus qu’ils ne disent[16].
Cette stratégie critique se retrouvera dans toute l’œuvre future de Blanchot. On en percevra la structure dans sa lecture des Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan, et elle s’affirmera avec force dans la prière d’insérer de Faux pas[17]. Mais pour mieux saisir son fonctionnement à ce stade initial, il convient d’examiner de plus près un texte clé de cette période : la lecture que Blanchot propose de Vie de Mallarmé.
2. Radicalisation de l’absence : du « génie » au « silence »
Le 14 juin 1940, quand l’on vit les régiments allemands occuper Paris, quelques-uns des hommes qui étaient restés, […] cherchèrent à quel opium ils demanderaient l’atténuation, sans doute illusoire, de leur douleur.
Nous choisîmes d’étudier une existence que nul n’avait encore entrepris de conter et où l’on trouve, pour se réconcilier avec la vie et certains prestiges français, d’extraordinaires vertus[18].
Ainsi s’ouvre le premier volume de Vie de Mallarmé. Plus de 300 pages plus loin, au moment d’interrompre son récit par les dates : « Paris 15 juin ── 15 décembre 1940 », Henri Mondor évoque une autre arrivée à Paris de Mallarmé en 1871, soulignant qu’« il n’a rien du héros résolu de Balzac qui défie la ville ou de l’un de ces avides conquérants »[19]. Cette prudence oblique, presque audacieuse, témoigne d’une double posture : maintenir une indifférence presque complète à la politique tout en préservant une sphère indépendante et intransigeante de la pensée, au cœur même de l’Occupation. Il n’est pas difficile d’imaginer que cette attitude ait profondément impressionné Blanchot en 1941.
Dès le 23 avril 1941, Blanchot présente à ses lecteurs le premier volume de Vie de Mallarmé, tout juste paru, dans un article intitulé : « Le biographe connaît le “génie” et ignore l’“homme” ». Il y salue l’approche de Mondor, qui ne s’attarde pas sur des détails anecdotiques de l’existence du poète. Car selon Blanchot, la biographie traditionnelle tend trop souvent à masquer l’œuvre elle-même, en ramenant les poèmes à de simples repères biographiques à partir desquels le lecteur en vient à ne plus voir dans le sujet de la biographie qu’un homme quelconque. À l’inverse, la démarche de Mondor est saluée précisément parce qu’elle échappe à cette tentation : mobilisant des documents jusqu’alors inédits, elle donne accès à ce que Blanchot appelle le « génie » du poète, entendu comme « une merveilleuse vie intellectuelle »[20]. Blanchot l’exprime ainsi :
On admire les fruits visibles de son art, mais on ne cesse de songer aux opérations qui n’ont abouti à rien de visible et dont tout l’acte a été dans une absence impénétrable et pure. Là le poète a vraiment saisi l’absolu et il a espéré l’exprimer en quelques mots par un prodige de combinaisons soustraites au hasard[21].
Ce passage prolonge, tout en le déplaçant, le propos du premier article de la Chronique, dans lequel Blanchot évoquait déjà Mallarmé comme « un homme qui […] sut dominer le monde par l’exercice pur d’un pouvoir d’expression absolu ». Ici, toutefois, la réflexion gagne en profondeur : il ne s’agit plus seulement d’exalter la maîtrise du langage, mais de souligner le décalage entre l’œuvre visible et une opération poétique invisible, plus essentielle encore.
Lorsqu’il écrit que l’intérêt du livre de Mondor est « de nous laisser rêver à une sorte de biographie intellectuelle de Stéphane Mallarmé »[22], c’est bien sûr Blanchot lui-même qui l’esquisse, à travers son commentaire[23]. On retrouve ici son geste critique, déjà esquissé dans sa première Chronique : celui d’un double discours, qui consiste à accompagner les paroles des autres pour faire entendre ce qu’elles ne disent pas explicitement ── une absence, une dimension cachée de l’œuvre[24].
Cependant, cette opération ne va pas sans susciter quelques doutes. Le passage de Vie de Mallarmé à la « vie intellectuelle » n’est-il pas trop rapide ? Cette lecture, aussi inventive soit-elle, n’est-elle pas aussi fragile ? Peut-on retrouver dans les lettres du poète, un « génie » insaisissable, une source invisible de l’œuvre ? Ces interrogations semblent d’autant plus légitimes que Blanchot lui-même, un an plus tard, dans un second article consacré à l’ouvrage de Mondor, infléchira cette lecture.
Le 1er avril 1942, Blanchot annonce la parution du second volume de Vie de Mallarmé. Pourtant, le ton adopté diffère sensiblement de celui de l’année précédente. Certes, il se félicite que Mondor ait enfin achevé sa biographie, mais dès les premières lignes ── qui ne figurent plus dans la version intégrale de Faux pas ── transparaît une forme de réserve[25]. Le lecteur attentif s’étonnera de lire que, face à cette biographie désormais complète, Blanchot affirme : « Hélas ! le livre est complet et l’essentiel lui manque. »[26]
Par cette formule, Blanchot semble revenir sur l’éloge qu’il avait formulé un an plus tôt[27]. Certes, la découverte du « silence de Mallarmé » repose sur une référence nouvelle : le second volume de Vie de Mallarmé, qui traite de la période postérieure à Igitur (1869), moment à partir duquel le poète parle moins directement de sa propre poésie. Dans cet article, Blanchot ne cite d’ailleurs plus qu’une seule lettre de Mallarmé datée d’après Igitur[28] ; en revanche, il accorde une place notable aux témoignages rapportés par les proches du poète.
Mais il ne s’agit pas simplement d’une interruption de la parole mallarméenne (le second volume contient, en réalité, de nombreux propos du poète). L’achèvement de la biographie contraint plutôt Blanchot à infléchir sa lecture précédente, qui croyait percevoir la manifestation du « génie » de Mallarmé, et à reformuler cette intuition sous une modalité plus radicale : celle du retrait. Ainsi écrit-il :
Si le silence de Mallarmé ne pouvait d’aucune manière être rompu, s’il était naturel et raisonnable que l’homme qui avait le plus clairement organisé et suivi le cheminement de son esprit ne laissât de son effort qu’un témoignage énigmatique, couronné par quelques œuvres inimitables, il n’est pas moins important que ce silence, ce fait d’être resté silencieux au milieu de tant de paroles puisse apparaître comme le secret même dont l’existence ne devait pas nous être révélée[29].
Blanchot explicite ici ce qu’il entend par « silence de Mallarmé » : non pas une simple absence de discours, mais une manière singulière d’être d’un secret toujours retiré au cœur même de la profusion verbale. Ce silence désigne une structure où l’on est sans cesse attiré vers une présence de l’absence. Ce que Blanchot nommait auparavant « génie » ── un travail réflexif, poétique et préparatoire qui rend possible l’œuvre ── se voit désormais reconduit, mais sous la forme plus radicale du silence. Ces deux notions désignent, au fond, une même absence originaire, une même source invisible, constitutive de l’acte poétique[30].
On retrouve ici un geste critique fondamental de Blanchot : accompagner les paroles jusque dans leur propre retrait, et prolonger leur mouvement jusqu’au point où elles laissent transparaître ce qu’elles ne peuvent dire. Ce mouvement critique entre en résonance avec une fameuse lecture déjà développée dans son premier recueil critique : Comment la littérature est-elle possible ? publié en février 1942. A partir de l’observation des « quelques mots de rétraction » de Fleurs de Tarbes[31], Blanchot en vient à discerner dans l’œuvre une « machine infernale » qui risque de mettre en question la littérature elle-même[32] : il transforme radicalement une histoire des lettres décrite par Paulhan en un problème théorique de langage propre à la littérature, mais toujours en suivant la question mallarméenne : « Quelque chose comme les Lettres existe-t-il »[33] ?
3. En guise de conclusion : pour un politique de l’absence
Chaque livre, un peu important, cache un secret qui le rend supérieur à ce qu’il peut être. C’est vers ce secret que le critique se dirige et c’est de lui qu’il s’éloigne, entraîné par le devoir de faire connaître à des lecteurs les ouvrages qui paraissent. Aussi sa marche est-elle piétinement et lourdeur. Et si elle se rapproche quelquefois du but, ce n’est que par un faux pas[34].
Pour conclure notre étude, nous ajoutons quelques commentaires à ce passage tiré de la prière d’insérer de Faux pas. Pour comprendre sa conception de la critique, il faudrait revenir à ses premières chroniques littéraires : ainsi remonterons-nous de décembre 1943 à avril 1942, puis à avril 1941, voire jusqu’à janvier 1937. Ce texte peut être réduit à trois éléments fondamentaux : 1) un livre qui apparaît, porteur d’un secret caché ; 2) ce secret, qui rend un livre supérieur à ce qu’il manifeste ; 3) l’accès à ce secret par un faux pas.
1. Dès sa première Chronique, Blanchot s’était détourné d’une lecture immédiate des œuvres contemporaines pour chercher en elles un secret silencieux. Cette stratégie de lecture s’affirme sur une distinction entre livre et secret, homme et génie, être et absence. Comme nous l’avons vu, il tente de se rapprocher d’une vie intellectuelle qui demeure radicalement absente, irréductible à toute formulation, mais qui se laisse deviner comme le centre même de l’œuvre.
2. Il serait vain de se limiter à ce qu’un livre donne à lire sans percevoir ce qui le dépasse, en particulier après le désastre qui a mis en péril non seulement la vie matérielle, mais aussi la vie intellectuelle. Blanchot ne se contente pas de répéter les paroles des autres : il les trahit, les infléchit, pour les orienter vers un nouvel horizon. Mais c’est une œuvre elle-même qui contient ce secret : en ce sens, le secret devient un critère de la critique[35]. Cette exigence se retrouve dans l’article intitulé « Le jeune roman » (14 mai 1941) : « Les livres ne valent que par le livre supérieur qu’ils nous conduisent à imaginer »[36]; mais aussi, plus tôt encore, dans « De la révolution à la littérature » (13 janvier 1937), où il affirmait que « la force d’opposition qui s’est exprimée dans l’œuvre même » se mesure à « son pouvoir d’appeler à l’existence de nouvelles œuvres, aussi fortes, plus fortes qu’elle, ou de déterminer une réalité supérieure »[37].
3. La logique du faux pas n’est pas difficile à comprendre, car sa lecture n’est pas toujours fidèle au texte lu. Mais il est important de préciser que cet accès à un secret se présente comme une erreur. Ce geste critique, qui se proclame faux, marque sa volonté de franchir les bornes du commentaire traditionnel, sa propre responsabilité de lecture ou même sa fierté comme critique. En outre il préfigure déjà ce que Blanchot développera plus tard dans L’Espace littéraire autour du regard d’Orphée : un regard qui tente de saisir l’invisible par l’« impatience » vouée à l’échec[38]. Mais ce mouvement orphique est déjà esquissé, sous la figure de la « distraction », dans une scène centrale de Thomas l’Obscur, où l’héroïne révèle un secret à travers une vision inattendue[39].
C’est un fait que Blanchot a poursuivi son travail d’écriture, jusqu’aux abords de la Libération[40], au sein d’un journal vichyste[41]. On pourrait, comme l’a fait l’historien Philippe Burrin[42], y voir un « accommodement », opposé à la figure mythique d’une résistance silencieuse telle que la propose Le Silence de la mer de Vercors. Pourtant, comme nous l’avons vu, ce que Blanchot accomplit pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est l’invention, en son nom propre, d’un espace critique silencieux, intransigeant et indépendant, à travers même ce que l’on nomme « accommodement ». Dans un journal vichyste, sa Chronique se fait lieu d’accompagnement des écritures contemporaines jusqu’à leurs secrets ── un espace véritablement utopique : une digue pour préserver la vie intellectuelle. Ainsi, ce que l’on appelle trop facilement « absence de politique » dans ses chroniques mérite d’être requalifié. Il s’agit d’un politique de l’absence : une manière d’intervenir dans le monde par un détour de l’écriture où l’effacement devient l’ultime forme d’exigence critique face à l’Histoire.
Cette recherche a été menée avec le soutien de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), dans le cadre du programme KAKENHI ── Grant-in-Aid for JSPS Fellows (numéro de projet JP24KJ0845).
Notes
-
[1]
Blanchot y a publié au total 173 articles et on retrouve 55 articles de Journal des débats dans le recueil critique nommé Faux pas publié en décembre 1943. Il est désormais devenu facile d’accéder aux autres textes seulement publiés dans le journal mais abandonnés, grâce à l’édition par Christophe Bident (Chroniques littéraires du Journal des débats. Avril 1941-août 1944, Christophe Bident (éd.), Paris, Gallimard, « NRF », 2007).
-
[2]
En ce qui concerne un article du 15 janvier 1942 traitant des Notes pour comprendre le siècle de Drieu La Rochelle, un article que Christophe Bident avait qualifié « de pure compromission » (Christophe Bident, Maurice Blanchot-partenaire invisible, Seyssel, Champ Vallon, 1998, p. 221), Leslie Hill a émis des réserves à ce jugement, voyant plus précisément l’attitude complexe de Blanchot contre l’œuvre de Drieu La Rochelle (Leslie Hill, « Le monde en ruines », Cahiers Maurice Blanchot, n˚ 1, mars 2011, p. 56-58).
-
[3]
En 1998, en commentant la Chronique de la vie intellectuelle jusqu’alors presque inconnue, Christophe Bident a mentionné tout d’abord cette indifférence : « Il faut voir l’élégance des chroniques de Blanchot côtoyer, avec une indifférence superbe, des articles ou des publicités propagandistes intolérables. » (Christophe Bident, Maurice Blanchot-partenaire invisible, op. cit., p. 181).
-
[4]
Cf. Michael Holland, « Blanchot et la sortie du nihilisme », Cahiers Maurice Blanchot, n˚ 1, op. cit., p. 65-78 (Michael Holland, Avant dire. Essais sur Blanchot, Paris, Hermann, « Le Bel Aujourd’hui », 2015, p. 223-248).
-
[5]
Par exemple, Gisèle Berkman écrit : « Le Blanchot de 1944, qui salue Michaux, n’est plus celui de 1941, qui manifestait une sorte d’élitisme littéraire dédaigneux et se réclamait, à mots couverts, d’une forme de nationalisme. » (Gisèle Berkman, « L’invention d’un geste critique », Cahiers Maurice Blanchot, n˚ 1, op. cit., p. 37). Dans une analyse globale et précise de Christophe Bident qui s’attache à l’utilisation du mot « orgueil », le même changement progressif de Blanchot est retracé. Pourtant en ce qui concerne l’article nommé « L’écrivain et le public » où Berkman retrouve « une sorte d’élitisme littéraire dédaigneux » et même « une forme de nationalisme », Christophe Bident conclut presque le contraire : s’est déjà esquissé le mouvement de pensée vers sa théorie littéraire qui consiste en « solitude » mais pas en « orgueil », au point que s’y lit « une position de résistance » (Christophe Bident, « De la chronique à la théorisation », Associations des amis de Maurice Blanchot (éd.), Blanchot dans son siècle, Lyon, Parangon/Vs, « Colloque de Cerisy », 2009, p. 104-117).
-
[6]
« Le Biographe connaît le “génie” et ignore l’“homme” », Journal des débats, 23 avril 1941, p. 3. Dans Faux pas, on retrouve aussi un article publié dans Revue française des idées et des œuvres en 1940, et des articles publiés dans L’Insurgé en 1937.
-
[7]
Henri Mondor, Vie de Mallarmé, t. I, Paris, Gallimard, 1941.
-
[8]
« Le Silence de Mallarmé » de Faux pas se compose de deux chroniques sur Vie de Mallarmé d’Henri Mondor (« Le Biographe connaît le “génie” et ignore l’“homme” », Journal des débats, art. cit. ; « Le Silence de Mallarmé », Journal des débats, 1er avril 1942, p. 3).
-
[9]
Chroniques littéraires du Journal des débats, op. cit., p. 11.
-
[10]
Ibid., p. 14-15.
-
[11]
On sait aujourd’hui qu’il y avait double censure dès l’autonome 1940 : censure allemande et autocensure ; « Liste Otto » qui recense les livres interdits par la censure allemande, et « Convention de censure » qui « permet aux éditeurs de publier sous leur propre responsabilité », à l’exception « d’ouvrages qui pourraient déplaire à l’administration allemande » (Pascal Fouché, L’Édition française sous l’Occupation, Paris, Bibliothèque de Littérature française contemporaine de l’Université Paris 7, 1987, vol. I, p. 49). Ce que Blanchot a indiqué ici par ces mots « véritable épreuve de stérilité », nous semble proche de ce que l’on connaît comme « autocensure » : impuissance d’un discours privé de liberté.
-
[12]
Chroniques littéraires du Journal des débats, op. cit., p. 14.
-
[13]
Selon Leslie Hill, son admiration de l’ouvrage de Mondor et des poèmes de Mallarmé était à ce moment-là loin d’être neutre sur le plan politique, car le poète était attaqué par la droite vichyste et collaborationniste qui l’avait accusé d’« une déchéance animale, ‘‘onaniste’’, ‘‘féminine’’, ou ‘‘étrangère’’ (c’est-à-dire, encore une fois : juive) » (Leslie Hill, Blanchot politique : Sur une réflexion jamais interrompue, Genève, Furor, 2020, p. 310).
-
[14]
Comme l’a noté Laurent Jenny, dans un discours politique de Blanchot des années trente, « la révolution est inconcevable et imprévisible avant d’exister. Rien ne saurait l’expliquer ni la laisser pressentir. Elle est l’‘‘impossible’’. » En ce sens, « la révolution est une fiction pure » (Laurent Jenny, « La révolution selon Blanchot », Je suis la révolution, Paris, Belin, 2008, p. 120 et p. 127). Mais on peut dire aussi que tout son discours consistait en une croyance à une force absolue de langage contre le monde matériel.
-
[15]
Chroniques littéraires du Journal des débats, op. cit., p. 16 et p. 17.
-
[16]
À propos de l’importance du premier article qui inaugure sa chronique littéraire et manifeste son propre point de vue, souvenons-nous aussi de deux premiers articles très connus de Blanchot : « De la révolution à la littérature » du 13 janvier 1937 qui inaugure « Les lectures de l’Insurgé » dans L’Insurgé ; « La solitude essentielle » du janvier 1953 qui manifeste l’essentiel de sa « Recherche » dans La Nouvelle NRF.
-
[17]
Il ne serait pas inexact d’entendre un lointain écho de cette stratégie critique dans un passage de « L’Absence de livre », son dernier texte consacré à Mallarmé : « Lire, ce serait lire dans le livre l’absence de livre, en conséquence la produire […] » (Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 626).
-
[18]
Henri Mondor, Vie de Mallarmé, t. I, op. cit., p. 7.
-
[19]
Ibid., p. 318. On peut lire encore aux mêmes pages dans Vie de Mallarmé. Édition complète en un volume publiée en 1942, les dates et les phrases citées ici qui ont conclu le premier volume.
-
[20]
Maurice Blanchot, Faux pas, Paris, Gallimard, 1943, p. 118.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Ibid.
-
[23]
Nous ajoutons ici un témoignage éclairant de Roger Laporte sur le commentaire de Blanchot qui nous laisse rêver à « une sorte de biographie intellectuelle de Stéphane Mallarmé » : « L’ouvrage de Henri Mondor justifie-t-il une telle méditation ? Ce n’est pas sûr, et plus d’une fois on éprouve une certaine déception lorsqu’on passe d’un commentaire de Blanchot au livre lui-même […]. Lorsque Blanchot commente un livre ne pense-t-il pas à un autre livre, encore non écrit ? », Roger Laporte, « Une passion », Roger Laporte et Bernard Noël, Deux lectures de Maurice Blanchot, Saint Clément de Rivière, Fata morgana, 1973, p. 67.
-
[24]
Que dès le début de sa carrière Blanchot s’intéressait à la biographie de Mallarmé, n’est pas anecdotique, d’autant que, pour lui, la littérature ne cesse de se doubler de la vie : comme l’a dit clairement Christophe Bident dans son essai récent, « Elle [littérature] joue le double jeu déjà décrit par Blanchot dans L’Espace littéraire, qui récusait l’auteur dès son préambule pour ne s’intéresser qu’à l’écrit (la « solitude essentielle » n’est même pas celle de l’auteur : elle qualifie l’œuvre) mais qui, à chaque page, faisait revenir la vie, car ce qui était commenté, c’était le journal de Kafka, non ses romans, la correspondance de Mallarmé et l’autofiction de Rilke, non leurs poésies. » Christophe Bident, La vie versée dans les récits (vers le nom de Blanchot), Genève, Furor, 2021, p. 12.
-
[25]
« Jusqu’à la publication de son livre, on ne possédait pas de biographie véritable de Mallarmé et l’on était presque heureux de n’en pas connaître. Il semblait que le vrai destin d’un tel poète fût de ne pas exister en dehors de sa poésie […]. Le travail de M. Henri Mondor met fin à cette rêverie. […] M. Henri Mondor aurait peut-être pu écrire la biographie de Mallarmé avec rien. » Maurice Blanchot, « Le Silence de Mallarmé », Journal des débats, art. cit, p. 3.
-
[26]
Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 121.
-
[27]
Yun Sun Limet formule ainsi ce changement, sinon un approfondissement : « D’un article à l’autre, on passe du témoignage par le génie sur son entreprise poétique au silence qui se fait sur elle. Et ce silence crée le secret même d’une œuvre. » Yun Sun Limet, Maurice Blanchot Critique, Paris, Éditions de la Différence, 2010, p. 55.
-
[28]
« Lettre à Paul Verlaine, 16 Novembre 1885 », Henri Mondor, Vie de Mallarmé, op. cit., p. 469-470. Nous reverrons cette lettre au début de l’article intitulé « Mallarmé et l’art du roman » (Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 189-196).
-
[29]
Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 125.
-
[30]
Après la guerre, on reverra plus développé ce thème de « silence » au cœur de l’écriture dans l’article intitulé « Le Paradoxe d’Aytré » (Maurice Blanchot, La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 66-78).
-
[31]
Maurice Blanchot, Comment la littérature est-elle possible ? Paris, José Corti, 1942, p. 17 (Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 94).
-
[32]
« Ne parle-t-il [Paulhan] pas d’autre chose que ce qu’il était censé dire ? Y aurait-il, cachée dans ses réfutations et ses arguments, une sorte de machine infernale qui, invisible aujourd’hui, éclatera un jour, bouleversant les lettres et en rendant l’usage impossible ? » Maurice Blanchot, Comment la littérature est-elle possible ? op. cit., p. 10. On ne voit plus ce passage dans la version de Faux pas. En ce qui concerne sa lecture de Fleurs de Tarbes, voir, entre autres, Gisèle Berkman « L’expérience-Paulhan : un art d’écrire en temps de guerre », La question juive de Maurice Blanchot, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2023, p. 63-83.
-
[33]
Stéphane Mallarmé, « La Musique et les Lettres », Œuvres complètes, t. II, Bertrand Marchal (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la pléiade », 2003, p. 65.
-
[34]
Prière d’insérer de Faux pas (1943), reproduite dans Cahiers de l’Herne Blanchot, L’Herne, septembre, 2014, p. 247.
-
[35]
Comme l’a noté Leslie Hill, Blanchot dit le contraire au sujet de Notes pour comprendre le siècle de Drieu La Rochelle : l’auteur « ne semble pas avoir voulu glisser sous son livre un livre secret qui en serait tout différent et qui garderait la clé de sa pensée véritable ; il ne répugne pas à exprimer en quelques mots faciles l’explication difficile de l’histoire » Chroniques littéraires du Journal des débats, op. cit., p. 122 (Leslie Hill, « Le monde en ruines », art. cit., p. 59).
-
[36]
Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 212.
-
[37]
Maurice Blanchot, « De la révolution à la littérature », L’Insurgé, n° 1, 13 janvier 1937, p. 3.
-
[38]
Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, [1955], « Folio essais », 1988, p. 225-232.
-
[39]
Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, [1941], réédition, 2005, p. 287-288. On peut retrouver la même scène dans une version précédente écrite dans les années trente (Maurice Blanchot, Thomas le solitaire, Leslie Hill et Philippe Lynes (éd.), Paris, Kimé, « Corpus Blanchot », 2022, p. 229-230).
-
[40]
La dernière chronique littéraire de Blanchot est publiée 17 août 1944, c’est-à-dire, la veille de la disparition de Journal des débats, une semaine avant la Libération de Paris.
-
[41]
Michel Surya a repris récemment « des articles ou des publicités propagandistes intolérables » dans lesquels ses chroniques littéraires étaient publiés comme l’a dit déjà Christophe Bident en 1998 (Michel Surya, À plus forte raison Maurice Blanchot, 1940-1944, Paris, Hermann, 2021). On a mis aussi en doute l’attitude politique de Blanchot quand on a retrouvé son nom comme directeur d’Aux écoutes au mois de juillet 1940, alors que l’hebdomadaire est favorable à l’instauration du régime de Vichy (David Uhrig, « Blanchot, du « non-conformisme » au maréchalisme », Lignes, n˚ 43, « Les politiques de Maurice Blanchot 1930-1993 », mars 2014, p. 122-139).
-
[42]
Philippe Burrin, La France à l’heure allemande 1940-1944, Paris, Seuil, 1995, p. 329-345.
pour citer cet article
NAKATA Ryotaro, « Absence de politique, politique de l’absence : essai sur les Chroniques littéraires de Maurice Blanchot : pendant la Seconde Guerre mondiale », Résonances, nº 16, 2025, pp. 35-46, URL : https://resonances.jp/16/absence-de-politique-politique-de-labsence/, page consultée le 14 février 2026.